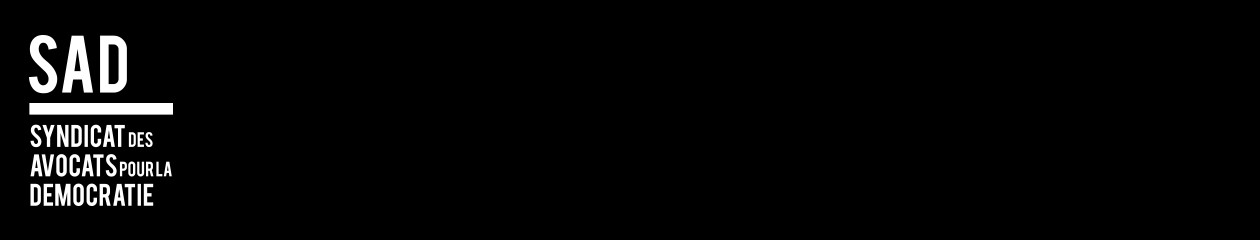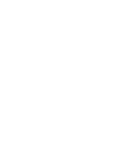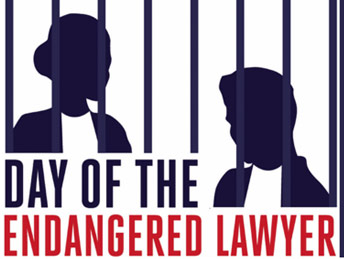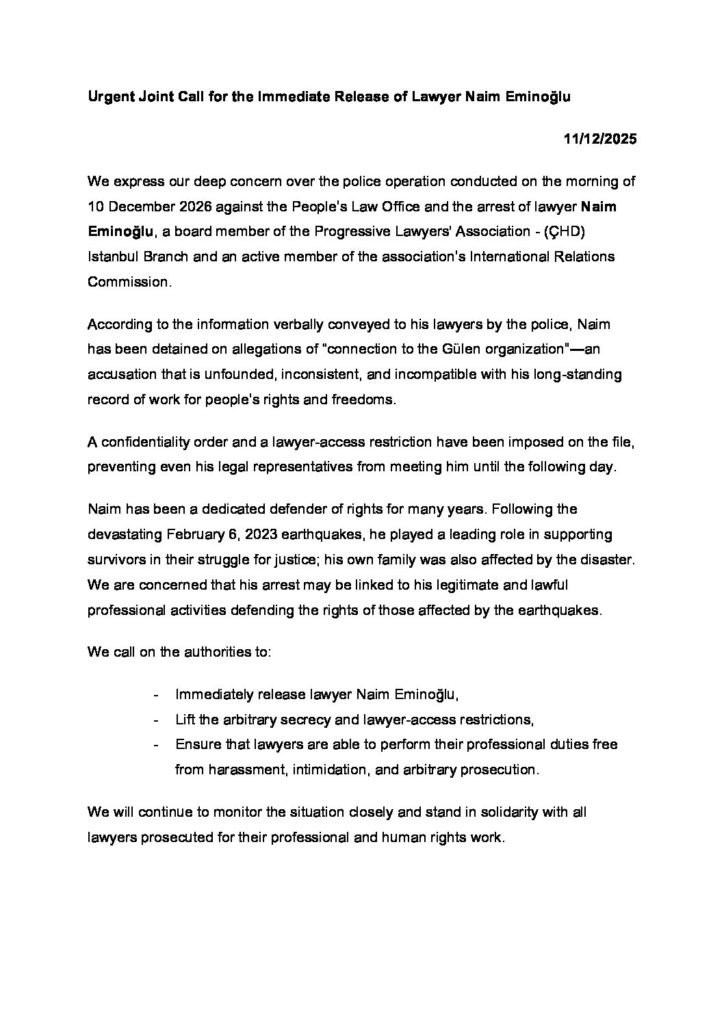Rapport de la mission
d’observation des audiences des 5/9 janvier 2026 – procès du Conseil de l’Ordre
d’Istanbul (procédure pénale)
Par Mes Frédéric UREEL
(Barreau de Charleroi) et Mireille JOURDAN (Barreau de Bruxelles)
++++
Les dernières élections au
Conseil de l’Ordre du Barreau d’Istanbul ont eu lieu en septembre 2024.
Une dizaine de listes étaient
proposées au vote.
À l’issue d’un scrutin salué
pour sa diversité et son ouverture, un nouveau Conseil de l’Ordre a été mis en
place, le bâtonnier élu étant Maître Ibrahim KABOGLU.
Suite à l’assassinat de deux
journalistes le 19 décembre 2024, alors qu’ils suivaient des événements en
Syrie, une conférence de presse avait été organisée à Istanbul.
Lors de celle-ci des citoyens –
dont des avocats membres du Barreau -, des étudiants et de nombreux
journalistes furent placés en garde à vue.
Après ces événements, le
nouveau Conseil de l’Ordre fit une déclaration s’appuyant sur les informations
relayées par la presse rappelant que le fait de prendre pour cible des membres
de la presse dans des zones de conflit constitue une violation du droit
international humanitaire et des conventions de Genève.
Il demandait qu’une enquête effective soit menée
et que les personnes placées en garde à vue après avoir exercé leurs droits
constitutionnels en tenant cette conférence de presse soient immédiatement
libérées.
Le
Procureur général d’Istanbul a alors ouvert une enquête pénale contre le Bâtonnier
d’Istanbul, Me İbrahim KABOGLU et les membres de son Conseil de l’Ordre, le 22 décembre 2024, des
chefs de « propagande terroriste » et de « diffusion publique
d’informations trompeuses », avant d’intenter une instance civile visant à
mettre fin aux fonctions du Bâtonnier et de l’ensemble du Conseil via une
procédure d’accusation civile dite « davaname » le 14 janvier
2025.
A l’audience du 21 mars 2025,
la deuxième chambre civile du Tribunal de première instance d’Istanbul a décidé
de révoquer les membres du Conseil et de faire procéder à l’élection d’un
nouvel organe dans un délai d’un mois au plus tard, une fois la décision
devenue définitive.
La voie de recours est actuellement
toujours ouverte.
Dans l’intervalle, le Barreau
d’Istanbul s’est réuni en assemblée générale extraordinaire le 23 février 2025
en présence de près de 8000 membres. Dans sa déclaration finale cette assemblée
générale a déclaré que le Conseil de l’Ordre issu d’une élection ne serait
remplacé que par la prochaine élection.
Les membres du Conseil sont
dès lors toujours en place.
Concernant l’aspect pénal de
l’affaire, l’acte d’accusation visant le Bâtonnier et 10 membres du Conseil de
l’Ordre pour « propagande terroriste » et « diffusion de fausses informations »
a été accepté par la 26ème chambre criminelle de la Cour d’assises
d’Istanbul.
Les audiences se sont tenues à
Silivri, à près de 100 km du centre, bien que le tribunal siège normalement à çaglayan (Istanbul).
Ce transfert a été contesté
comme inconstitutionnel.
Il est précisé que le tribunal
de Silivri est un tribunal d’exception bâti au cœur même de la prison
gigantesque de Silivri, où sont détenus près de 22.000 prisonniers, dont nombre
de prisonniers politiques, parmi lesquels le maire d’Istanbul.
Le fait même de la tenue des
audiences dans ce palais–prison a été dénoncé à plusieurs reprises au cours des
débats par divers avocats de la défense, le fait qu’un procès pénal se tienne
dans une juridiction installée au sein d’un complexe pénitentiaire créant
l’apparence d’une sanction infligée avant tout jugement.
Les journées du 5 au 9 janvier
2026 se sont ouvertes par le rappel de l’acte d’accusation du procureur, qui
allègue que « la présidence et le Conseil de l’Ordre, organe directeur
responsable du barreau d’Istanbul, considéré comme une organisation
professionnelle de la nature d’une institution publique, participe à des
activités illégales en agissant en dehors de leur but et des pouvoirs et
devoirs qui leur sont assignés. »
L’acte d’accusation se réfère
à un écrit présenté, sur une demi-page et non développé verbalement en audience
publique.
Le ministère public reproche
au Bâtonnier et aux membres du Conseil de l’Ordre sur base du code pénal et de
la loi antiterroriste:
– une
propagande en faveur d’une organisation terroriste
– une
diffusion publique d’informations trompeuses.
A l’ouverture du procès le Bâtonnier
en personne prend la parole pour demander le renvoi de la cause devant la Cour
constitutionnelle au motif de l’inconstitutionnalité des dispositions sur
lesquelles se fondent les poursuites.
La violation invoquée repose
sur la limitation de la liberté d’expression prévue dans la Constitution turque
mais aussi dans les instruments internationaux ratifiés par l’état turc.
Malgré une plaidoirie de très haut
niveau dans sa construction juridique et ses références internationales, la
cour, après avoir délibéré, quelques minutes à peine, a rejeté la demande de
renvoi telle que sollicitée et a invité les parties à poursuivre les débats au
fond.
La cour a alors invité chacun
des accusés à prendre la parole à son tour.
Chacun – avec brio et
conviction – fait part de ses contestations et dénonce avec émotion et réalisme
la violence des poursuites, qui sont sans lien avec la déclaration de presse en
cause.
Près de 25 avocats vont se
succéder du lundi au mercredi, pour assurer la défense de chacun des accusés,
dont les bâtonniers de plusieurs grandes villes et le Président de l’Union
nationale des Barreaux.
La défense repose à la fois
sur des vices de procédure entraînant la nullité des poursuites et sur des
arguments de fond.
Pour ce qui est des vices de
procédure,
- l’enquête a été ouverte sans autorisation
préalable du ministère de la justice, en violation flagrante de la loi sur la
profession d’avocat et du principe du procès équitable, l’autorisation
ministérielle (omise au départ) étant en effet intervenue alors que l’acte
d’accusation avait déjà été rédigé,
- l’enquête a été divulguée à la presse, ce qui
constitue une violation du secret de l’instruction,
- les membres du Conseil n’ont pas été
formellement entendus avant l’autorisation d’enquête, les empêchant de
soumettre des éléments au dossier,
- Le tribunal de Silivri est un tribunal
d’exception alors que le juge naturellement compétent est celui de çaglayan (Istanbul).
Sur le fond, la défense
rappelle notamment que
- Le Barreau est une institution publique autonome, au
croisement de l’État de droit et de la société démocratique.
- Il a pour mission constitutionnelle de protéger les droits fondamentaux,
notamment le droit à la vie, à un procès équitable, à la liberté d’expression
et à l’information.
Dès lors, les avocats constatent
- l’absence des
éléments matériel et intentionnel : le seul fait reproché est une demande d’enquête,
qui ne saurait constituer un crime ; elle ne contenait aucune mention de terrorisme,
aucun passage de la déclaration ne
légitimant, ne glorifiant ni n’encourageant l’usage de la violence au sens de
l’art. 7/2 de la Loi 3713 (antiterrorisme) ;
- l’absence
d’allégation factuelle mensongère, la déclaration se fondant sur des dépêches
de presse concordantes (institutions
comme le Conseil de la
presseou l’Union
des journalistes de Turquie) et appelant au respect du droit international
humanitaire (infraction à l’art. 217/A du Code Pénal) ;
- un procès d’intention dans le chef du
parquet, en vue de criminaliser un acte légitime de défense des droits par le Barreau.
Ils
rappellent également que les art. 26, 28 et 34 de la Constitution ainsi que les
instruments internationaux offrent une protection renforcée de la liberté
d’expression institutionnelle du Barreau.
Dans de
nombreuses déclarations des accusés eux-mêmes ainsi que dans les plaidoiries de
leurs avocats, il est régulièrement apparu que vu le caractère non juridique
mais essentiellement politique des poursuites la défense devait se placer sur
le même terrain.
Ce procès
s’inscrit selon la défense dans le cadre d’une criminalisation croissante des
opposants et de la société civile.
Ont ainsi
notamment été rappelés l’absence de toute enquête ou suite donnée à des
assassinats ou disparitions (notamment de citoyens kurdes), l’incarcération de
mandataires politiques, tels que le maire d’Istanbul ou d’autres villes
turques.
De manière
générale a été dénoncée l’inféodation du judiciaire au pouvoir politique
(certains ayant même fait le parallèle avec des régimes totalitaires passés ou
actuels).
Divers
avocats ont appelé à l’émergence de valeurs démocratiques réelles, dans le
cadre du respect de droits effectifs.
Les
plaidoiries ont été intenses et les nombreuses délégations présentes (liste en
annexe) ont été impressionnées par leur qualité juridique, appelant de leurs
vœux un véritable changement démocratique.
Aucune
audience ne se tint le jeudi.
Le vendredi,
le temps a été donné aux accusés pour de dernières brèves déclarations.
Il a
notamment été souligné lors de celles-ci qu’une campagne de dénigrement avait
été orchestrée par certains dès le soir de l’élection et que la déclaration
faite avait servi de prétexte aux poursuites, celles-ci étant vues comme une ‘guerre’
faite au Barreau – considéré comme un rival politique – et comme une instrumentalisation
du pouvoir judiciaire.
Après une
suspension d’audience d’une trentaine de minutes, pour laquelle la présidente
avait ordonné l’évacuation de la salle (environ 400 avocats étant présents), la
cour revint très brièvement, la présidente se bornant à annoncer au micro que
les accusés étaient acquittés.
Des scènes
de liesse s’en sont suivies.
Dans le courant de l’après-midi, nous avons été informés que le parquet avait interjeté appel.
Affaire à suivre donc…
Silivri, le 9 janvier 2026
Délégations des organismes
et institutions suivantes
German
Federal Bar,
German
Bar Association,
Berlin
Bar Association,
Karlsruhe
Bar Association,
Marseille
Bar Association,
Grenoble
Bar Association,
Amsterdam
Bar Association,
Rotterdam
Bar Association,
Paris
Bar Association,
Brussels
Bar Association,
Charleroi
Bar Association,
Liége-Huy
Bar Association,
Geneva
Bar Association,
Norwegian Bar Association,
Hauts-de-Seine Bar
Association,
Saine-Saint-Denis
Bar Association,
Rennes
Bar Association,
Montpellier
Bar Association,
Spanish
National Bar Council,
Lyon
Bar Association,
Sofia
Bar Association,
Haskovo
Bar Association,
Supreme
Bar Council of Bulgaria,
Lille
Bar Association,
Toulouse
Bar Association,
Bologna
Bar Association,
Brescia
Bar Association,
Bordeaux
Bar Association,
Turin
Bar Association,
Polish
Bar Council,
Berlin/Hamburg
Organisational Office of the Criminal Defence Associations,
Republican Lawyers’
Association (RAV),
La Conférence des Bâtonniers
de France,
Conseil National des
Barreaux de France (CNB),
Lawyers for Lawyers (L4L),
Défense sans frontières –
avocats solidaires (DSF-AS),
Union
Internationale des Avocats – Institute for the Rule of Law (UIA-IROL),
The
International Observatory for Lawyers in Danger (OIAD),
Avocats Européens Démocrates
(AED/EDL),
Vereniging
Sociale Advocatuur Nederland (VSAN),
Conférence Internationale
des Barreaux de tradition juridique commune (CIB),
Fédération des Barreaux
d’Europe (FBE),
Ordre des barreaux
francophones et germanophone de Belgique (OBFG),
Democratic
Jurists Switzerland (DJS),
European
Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights (ELDH),
The
Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE),
Osservatorio
Avvocati Minacciti dell’ Unione delle camere penali italiane (UCPI).
Countries
represented: France, Germany, Netherlands, Italy, Belgium, Switzerland,
Bulgaria, Spain, Norway, Poland Bar Associations/councils,
Furthermore
for FBE: Azerbaijan, Czech Republic, Ireland, Luxembourg, Portugal, Rep.
Kosovo, Romania, Austria, Ukraine, United Kingdom, Greece,
Furthermore
for CIB: Armenia, Algeria, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central
African Republic, Comoros, Republic of the Congo, Ivory Coast, Djibouti, Gabon,
Guinea-Bissau, Republic of Guinea, Mauritius, Madagascar, Mali, Morocco,
Mauritania, Niger, Democratic Republic of the Congo, Rwanda, Senegal, Chad,
Togo, Tunisia, Canada, United States, Guadeloupe, Saint Martin, Saint
Barthélemy, Haiti, Martinique, Cambodia, Laos, Lebanon, Syria, Vietnam
Furthermore
for CCBE: Cyprus, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Iceland, Latvia,
Liechtenstein, Lithuania, Malta, Slovak Republic, Slovenia, Sweden, Montenegro,
Serbia, Albania, Bosnia and Herzegovina, Georgia, North Macedonia, Moldova,
Andorra, San Marino